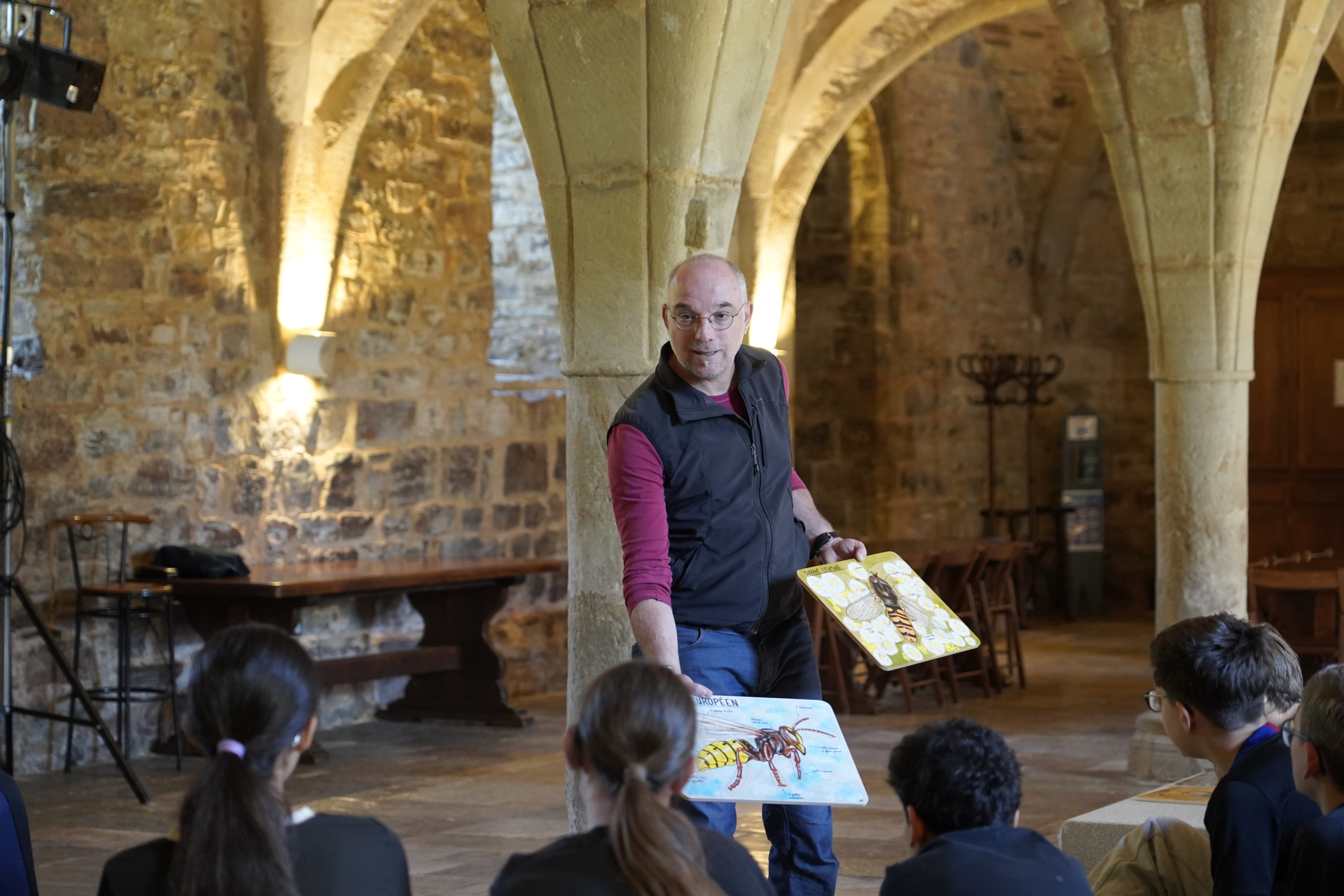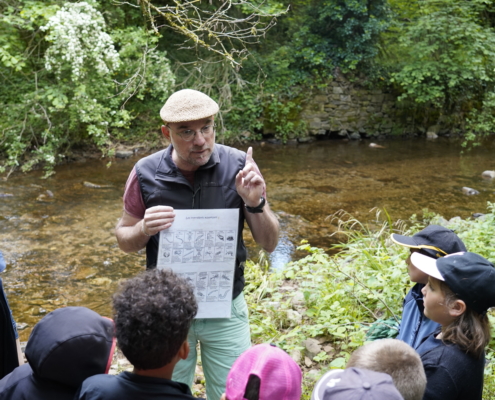Chorale à l’école : rencontre avec Anna Claire Golitzin
Anna Claire Golitzin a quitté Londres où elle travaillait comme chanteuse indépendante pour s’installer en Aveyron. Musicienne intervenante rattachée au Conservatoire de l’Aveyron depuis quelques mois, elle poursuit le travail de transmission au cœur du projet « Chorale à l’école » porté par l’Abbaye de Sylvanès. Entre héritage familial et pédagogie passionnée, elle accompagne les enfants dans la découverte de leurs voix, avec une conviction profonde. Rencontre en quelques lignes avec Anna Claire Golitzin.
Quel est votre premier souvenir musical et d’où vous vient cette passion pour la musique ?
Mes parents étaient musiciens et mes premiers souvenirs remontent à l’enfance quand la musique résonnait en permanence dans la maison. Mon père jouait du piano et ma mère chantait en s’accompagnant à la guitare. Nous fréquentions régulièrement en famille l’église orthodoxe de notre village où le chant occupait une place très importante dans les offices. C’est là qu’est née ma passion pour le chant choral et mon envie de poursuivre des études dans ce domaine. Par la suite, j’ai intégré un master en histoire de la musique ancienne et chant renaissance à l’Université de York, en Angleterre, où j’ai pu me former auprès de grands chanteurs et approfondir ma pratique.
Comment êtes-vous arrivée dans l’aventure « Chorale à l’Ecole » ?
Mon installation en Aveyron était motivée par mon désir de transmettre la musique chorale issue des traditions slaves. Parallèlement, je souhaitais travailler avec des enfants et quand j’ai appris que le Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Aveyron recherchait un professeur pour assurer la continuité du projet « Chorale à l’école », j’ai postulé. Cette opportunité correspondait parfaitement à mes aspirations.
Comment se déroulent les ateliers dans les classes ?
J’interviens tous les quinze jours pendant 45 minutes dans chaque classe des 11 écoles participantes et auprès de 170 élèves. Chaque classe est différente et c’est ce qui rend les ateliers intéressants. Les enfants ont des expériences très variées avec le chant. Certains chantent naturellement, tandis que d’autres ont plus de difficultés à reproduire une note ou à tenir une note accompagnée au piano. Mon rôle consiste à les accompagner progressivement par l’intermédiaire de chansons adaptées. C’est très satisfaisant de constater leurs progrès.
Selon vous, la musique à l’école est-elle indispensable ? Pourquoi ?
Oui, elle est indispensable ! C’est vraiment durant l’enfance qu’il faut initier cette pratique car pour avoir travaillé avec des adolescents, je me suis rendue compte que ceux qui n’avaient jamais chanté auparavant, étaient persuadés qu’ils n’en étaient pas capables. La musique ouvre quelque chose de très profond dans l’esprit de l’enfant et lui apporte beaucoup de bénéfices. Le chant aide d’ailleurs énormément à l’apprentissage des langues.
Si ce projet devait être associé à une couleur et à une émotion, lesquelles choisiriez-vous ?
Je choisirais la couleur rouge et pour l’émotion, le courage. C’est une notion que je répète souvent aux enfants. Je les encourage à oser chanter, à prendre confiance en eux. Par exemple, je peux mettre en avant un élève qui a bien chanté et inviter les autres à suivre son exemple avec davantage d’assurance. Le rouge symbolise aussi la passion. En tant que « performer », je vois à quel point il faut mettre la passion et la performance dans la musique et dans ce que l’on fait. C’est cette énergie et cette ferveur que j’essaie de transmettre aux enfants à travers le répertoire et le travail collectif.
À l’issue des ateliers dans les classes, une restitution finale sera présentée aux familles le mardi 16 juin à 14 h en l’abbatiale de Sylvanès !
Initié par l’Abbaye de Sylvanès, Centre culturel de rencontre, ce projet est mené en partenariat avec la Communauté de Communes Monts Rance et Rougier, le Conservatoire à Rayonnement Départemental de l’Aveyron, le Département de l’Aveyron et le soutien de l’Éducation nationale.